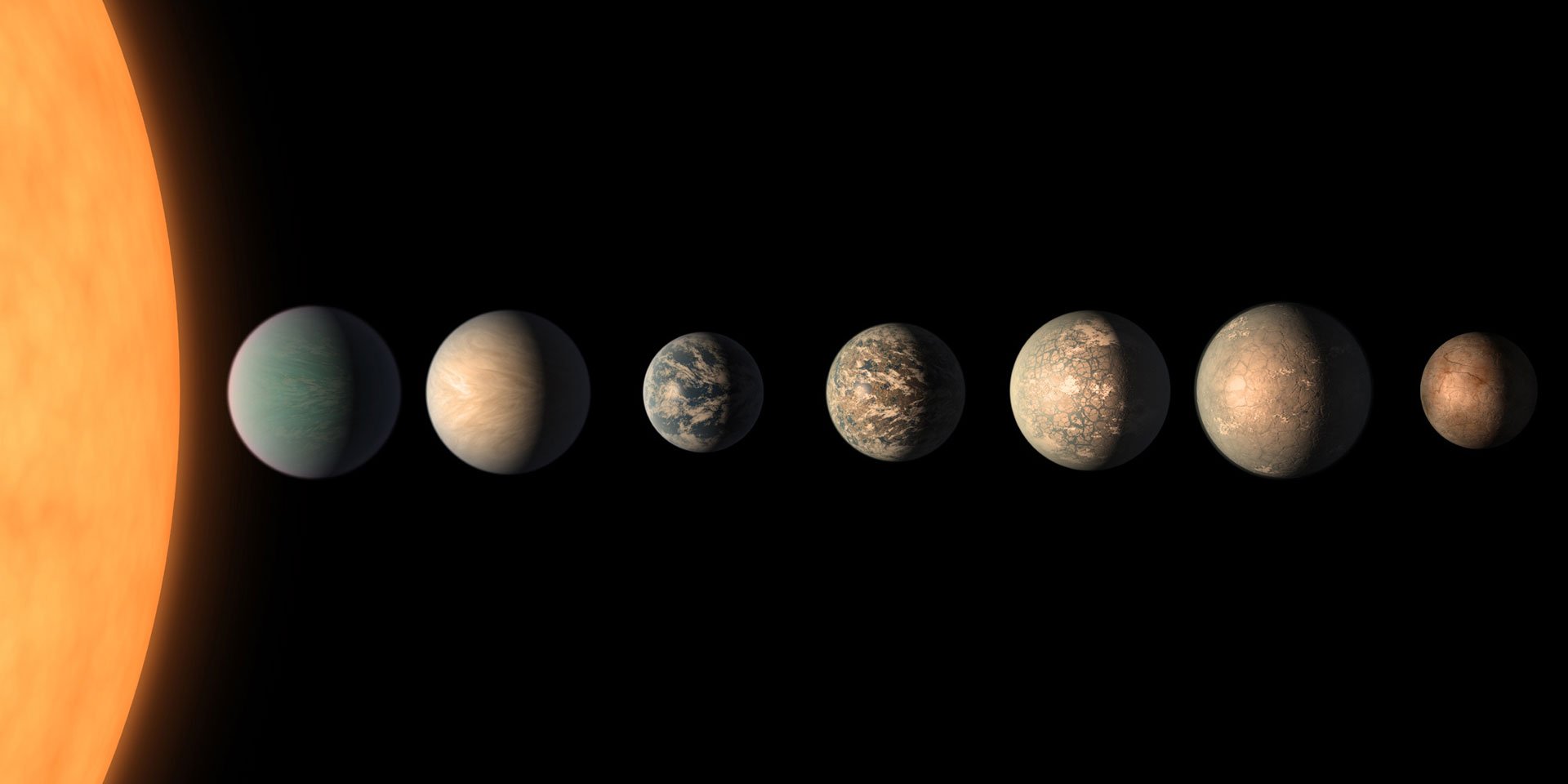Étude révèle des indices sur la formation et l’évolution des exoplanètes
À mesure que les astronomes explorent la diversité des mondes qui orbitent autour d’étoiles lointaines, une nouvelle étude suggère que la comparaison entre les populations de jeunes exoplanètes et celles des plus anciennes pourrait révéler des indices vitaux sur la façon dont les planètes se forment, évoluent et changent avec le temps. Cette approche pourrait finalement fournir des réponses à certains sujets largement débattus, tels que l’existence d’un désert de Neptune chaud, qui fait référence à la curieuse rareté des planètes de la taille de Neptune en orbite serrée autour de leurs étoiles, et la vallée des rayons, un écart distinct entre les planètes ayant environ 1,5 et 2 fois le rayon de la Terre.
Étudier les exoplanètes jeunes pour comprendre leur état primitif
L’observation des exoplanètes jeunes offre une opportunité unique d’étudier des planètes à l’état primitif, avant qu’elles subissent les changements atmosphériques et évolutifs importants observés dans les populations plus anciennes. Grâce aux missions de transit à grand champ et à haute précision, telles que celles menées par la NASA avec les missions Kepler et TESS, il est possible de recueillir de telles observations. Ces missions permettent aux astronomes d’étudier des exoplanètes situées à des millions, voire des milliards, d’années-lumière de la Terre, avec un remarquable niveau de détail en mesurant de petites baisses de luminosité des étoiles lorsque les planètes passent devant elles depuis notre perspective dans le cosmos. En surveillant ces baisses, les astronomes peuvent déduire la présence d’une planète, sa taille et la durée de son orbite.
Notre capacité à détecter et observer des planètes jeunes est souvent limitée par le bruit de l’étoile hôte de la planète, a déclaré Galen Bergsten, doctorant à l’Université de l’Arizona. Nous devons détecter des signaux subtils qui peuvent se perdre dans le bruit. Les planètes jeunes orbitent autour d’étoiles jeunes, et les étoiles jeunes ont tendance à être très bruyantes, ce qui rend l’extraction des signaux de leurs planètes encore plus difficile.
Les jeunes exoplanètes révèlent des changements importants
Notre analyse se concentre sur les planètes à courtes orbites de 12 jours, a déclaré Rachel Fernandes, postdoctorante à l’Université d’État de Pennsylvanie. Nous avons constaté que les planètes changent avec le temps de deux manières importantes : elles rétrécissent en perdant leur atmosphère et se déplacent vers l’intérieur en raison des interactions avec leur étoile.
Cependant, 12 jours ne représentent qu’une petite fraction de l’espace, a-t-elle souligné. Pour comprendre vraiment comment les planètes évoluent, nous devons étudier à la fois les planètes proches et éloignées à différents stades de leur vie. Cela pourrait nous aider à déterminer la vitesse à laquelle les planètes migrent vers l’intérieur et à quelle vitesse elles perdent leur atmosphère – deux grandes questions auxquelles nous n’avons pas encore de réponses claires.
Comparaison des populations de jeunes et d’anciennes exoplanètes
L’équipe a divisé les sujets observés en deux groupes d’âge : les jeunes planètes (10 millions à 100 millions d’années) et les planètes de l’âge intermédiaire (100 millions à 1 milliard d’années). Ils ont ensuite comparé les taux d’occurrence de ces planètes en utilisant les données du télescope spatial TESS de la NASA pour la population plus jeune et celles du télescope Kepler pour la population plus ancienne. En bref, les scientifiques ont constaté une occurrence plus élevée de jeunes planètes.
Le fait que nous observions une occurrence plus élevée pour les jeunes planètes par rapport aux anciennes nous indique que les planètes pourraient se rétrécir, a déclaré Galen Bergsten. Dans les premières étapes de la formation et de l’évolution des planètes, nous pensons que les petites planètes étaient très courantes. Mais elles se refroidissent et perdent leur atmosphère au fil du temps, ce qui les fait rétrécir à des tailles plus petites que nous ne sommes pas sensibles avec la plupart des études.
Migrations planétaires par effet de marée
L’équipe spécule également sur le rôle de la migration planétaire par effet de marée dans la formation des planètes à période courte. Il s’agit du processus par lequel les planètes se déplacent progressivement plus près de leur étoile en raison de l’attraction gravitationnelle de celle-ci. Cela fait perdre de l’énergie à la planète et l’amène à se déplacer vers l’intérieur au fil du temps, souvent en résultant en des orbites beaucoup plus courtes.
Comprendre la migration planétaire par effet de marée est important car cela nous aide à expliquer comment et pourquoi certaines planètes finissent par avoir des orbites aussi courtes et ce qui leur arrive lorsque elles migrent vers l’intérieur, a déclaré Rachel Fernandes.
Un avenir excitant pour la recherche des exoplanètes
Les prochaines missions fourniront des données plus détaillées, permettant de meilleures observations de planètes plus éloignées de leurs étoiles et de planètes plus petites avec une plus grande précision. L’étude des étoiles avec une grande précision sur de longues périodes pourrait améliorer notre capacité à détecter et caractériser les jeunes planètes en orbite autour de ces étoiles.
Tout ce que nous savons sur les planètes provient des moins de 6 000 que nous avons découvertes jusqu’à présent, a déclaré Rachel Fernandes. Mais dans les prochaines décennies, les missions de la NASA et de l’ESA, comme Roman, PLATO et Gaia, en trouveront des dizaines à des centaines de milliers d’autres. Cela nous aidera à reconstituer l’image complète de la formation et de l’évolution des planètes et à replacer notre propre système solaire dans son contexte.
Avec autant de nouvelles données en perspective, les prochaines décennies seront extrêmement passionnantes pour la recherche des exoplanètes, a conclu Rachel Fernandes.
L’étude de l’équipe a été publiée le 17 mars dans la revue The Astronomical Journal.